

Ce recueil d’articles publiés par Jossot entre 1897 et 1947 a été réalisé au cours d’un séjour de recherche à Tunis. En 2012, Les éditions Finitude ont décidé de publier une partie de ces textes, en deux volumes. Le premier, intitulé Sauvages Blancs !, est prévu pour le 15 mars 2013. Ces livres intéresseront l’histoire des relations franco-tunisiennes, mais le but est aussi de montrer combien ces chroniques prennent le relais d’une œuvre caricaturale, tant dans leur contenu que dans leur écriture. Une partie des articles proposés ci-dessous ont été exposés à la bibliothèque Forney, en 2011, lors de l'exposition Jossot.

Extraits
Ce titre déconcertera les artistes officiels pour qui la décoration est un art inférieur et la caricature un amusement de rapin. D’après eux, cultiver l’art, le grand, c’est se borner exclusivement à enchâsser dans un cadre doré un morceau de toile peinte. Aussi la décoration est-elle considérée comme un métier abandonné à une tourbe d’ouvriers barbouilleurs qui copient servilement des fleurs ou des bêtes et prodiguent leur habilité d’exécution pour arriver à donner l’illusion du relief. Voilà pourquoi, encore de nos jours, il n’est pas rare que l’on voie s’épanouir dans un salle à manger, par exemple, des multitudes de chardons à ce point « bien faits » qu’on en voudrait manger, ou que l’on voit se promener paisiblement des lions et des tigres dans une chambre à coucher.
Ils ne comprennent pas, ces insanes, que la peinture décorative doit s’harmoniser non seulement avec les lieux qu’elle a pour mission de décorer, mais encore avec l’état d’esprit des gens qui sont appelés à les fréquenter. Une salle de billard, une salle à manger, un fumoir, un café, une brasserie sont des endroits joyeux : ne mettez pas de la mythologie sur leurs murs. C’est de ce principe d’une harmonie nécessaire que je me réclame pour instaurer la décoration caricaturale, parce que la caricature se plie à tous les sentiments, à tous les « états d’âmes », à toutes les dispositions permanentes ou passagères, avec une souplesse merveilleuse. Elle traduit jusqu’à l’outrance l’enjouement aussi bien que l’amertume, la noblesse d’une pensée haute ou la trivialité d’un penchant terre-à-terre. Nulle forme d’art ne possède une gamme aussi riche de nuances morales, qui lui permette, tout en restant elle-même, de passer en un instant aux extrémités les plus contraires ou de juxtaposer, sans blesser le regard, les antithèses les plus inattendues.
Avant toutes choses, que la décoration soit linéaire, parce que l’abus des reliefs et des profondeurs dénature les proportions d’une muraille. Un mur, une cloison, sont par définition des surfaces planes qui doivent rester planes. Or, si chacune de ces surfaces reçoit une décoration de nature à en altérer la perspective, la salle elle-même, qui n’est, en somme, que leur assemblage, en sera fâcheusement déformée. L’oeil sera douloureusement impressionné par des lointains ou des trompe-l’oeil qui semblent tantôt porter au loin le mur que l’on sait proche, tantôt rétrécir une étendue qui perd ainsi le bénéfice de ses dimensions véritables. Qu’après cela, la décoration puise, si bon lui semble, ses éléments dans la nature, je n’y vois nul inconvénient, mais qu’elle s’en écarte le plus possible. Plus le peintre s’efforcera de copier la nature, plus il fera de la peinture « attrape nigauds » qui est l’antipode de la peinture décorative. Un artiste Belge, M. Van de Velde, l’a bien compris, lui qui, non seulement ne copie pas la nature, mais la répudie complètement en un art fait exclusivement de lignes. Un point d’interrogation, une clef de sol, ne sont-ce pas là des motifs très décoratifs, malgré qu’ils ne dérivent de rien ? Pourtant n’employer que des lignes, c’est rejeter, de gaieté de coeur, l’expression et le mouvement. J’utilise donc la flore, la faune et même l’homme.
Contrairement aux prétendus peintres décorateurs, je ne me contente pas de copier servilement la figure humaine et de l’encadrer dans des fioritures : je puise en elle mes éléments décoratifs. Convaincu que la caricature peut et doit prétendre à un rôle plus large que celui qu’elle a tenu jusqu’à ce jour, je l’étends à la décoration en alliant le grotesque à l’arabesque. Les sentiments tels que la douleur, le rire, la surprise, la colère, la frayeur, etc. provoquent des torsions, des convulsions, des déformations qui me fournissent une infinie diversité de lignes. Je veux styliser les figures humaines ou animales en un grotesque monstrueux. Si l’on m’objecte que l’oeil peut se fatiguer de ces monstruosités, je réponds que je ne traite pas de la même façon l’ornementation d’un fumoir où l’on se repose et celle d’une salle de danse où l’on s’agite ; le premier endroit est intime, le second est envahi par la cohue ; l’un sera décoré familièrement mais avec sobriété, tandis que la gaîté de l’autre ira jusqu’à la folie.
J’espère appuyer d’ici peu, par des oeuvres, la conception que ces notes brèves prétendent à peine indiquer.
Jossot, 1899.

Les « Humoristes » m’ont refusé un tableau qu’ils jugent insuffisamment drôle.
C’est une chimère crucifiée : ses deux ailes éployées sont clouées à la croix et, sur la blancheur des plumes, le sang dégouline… il dégoutte sur l’épaule d’un gendarme préposé à la garde de la victime et au maintien de la foule exaspérée.
Les organisateurs du Salon paraissent croire que l’humour doit toujours agiter la marotte à grelots ; ne leur en déplaise, il peut aussi brandir le fouet de la satire. Le véritable humoriste n’est point forcément un « rigolo » de Montmartre, mais parfois un penseur solitaire.
L’humour s’exprime sur trois modes différents : parole, écriture, dessin.
Quand il dessine, l’humoriste se mue en caricaturiste.
La plupart de nos contemporains, ignorant le sens exact de cette appellation, il me paraît nécessaire de la définir : on l’emploie trop fréquemment pour désigner tout collaborateur d’une feuille illustrée. Des artistes de grand talent, Steinlen par exemple, se voient bombardés caricaturistes bien malgré eux, et, par suite de cette interprétation erronée, les moindres dessinateurs du plus petit journal pour rire sont, eux aussi, étiquetés caricaturistes. Le plus insignifiant des dessins représentant la plus inexpressive des « p’tit femmes » est considéré comme une caricature. Une formule d’art très spéciale se trouve donc méconnue par les artistes eux-mêmes, ravalée au rôle d’amusette pour siroteurs d’apéritifs.
Il est grand temps de remettre les choses au point ; je vais tenter de le faire.
Le caricaturiste est, avant tout, un irrespectueux : il crache sur tout ce que les croyants révèrent ; c’est un révolté, oui certes ; c’est même un révolutionnaire, mais pas dans le sens vulgaire du mot : il ne se bat qu’à coup d’idées, sachant bien que les coups de fusils ne font pas avancer l’Evolution.
Il s’attaque à l’Arche sainte qui contient les suprêmes respects des croyants, et brandit deux armes : la plume et le crayon, car un dessin sans légende n’est pas une caricature. Et si la légende n’est pas satirique, si elle ne flagelle pas un vice ou un préjugé, si elle ne se gausse pas des institutions surannées, si elle n’assaille pas les lois iniques, le dessin qu’elle souligne rentre dans le domaine de la simple illustration.
Mais la caricature, elle, reste accrochée aux murs ; traîne sur les tables, dans les appartements, les cafés, les antichambres des médecins ou des dentistes ; on la trouve chez le riche comme chez le pauvre ; l’ouvrier l’emporte à l’atelier, l’employé à son bureau. Dans la rue elle éclate et rutile aux kiosques de journaux, aux devantures des libraires ; tout le monde la voit : image, elle prend place dans les cerveaux, ces réceptacles d’images. Et dix, vingt, trente ans après qu’elle a paru, on la retrouve au fond d’une malle, sur le dernier rayon d’un vieux meuble, dans la poussière d’un déménagement.
Le caricaturiste peut imposer ses idées jusqu’à l’obsession et, pour arriver à ce résultat, pour être un réformateur, il doit, avant tout, être un déformateur.
La caricature c’est la déformation des êtres et des choses, c’est l’art de déshabiller les laideurs et de les clouer au pilori en les graphiant par des traits bistournés, tarabiscotés, tirebouchonnés jusqu’à la souffrance ; par des traits qui violentent les rétines et s’impriment d’une façon indélébile dans les encéphales ; par des traits essentiels et définitifs.
J’estime avoir suffisamment prouvé que la caricature peut et doit prétendre à un rôle plus élevé que celui où veulent la confiner les « rigolos ». Je crois aussi avoir montré que la besogne du caricaturiste ne consiste pas à faire tressauter d’aise les bedaines des brutes, mais à semer, dans les cerveaux qui pensent, des idées salvatrices. Toutefois, le caricaturiste doit posséder, au plus haut point, le sens du comique afin d’outrer les ridicules, afin d’amalgamer la drôlerie à l’âpreté, l’ironie à la virulence et de pouvoir présenter dans une cabriole clownesque les choses qui, dites par un moraliste, déclencheraient le bâillement universel.
Dans une caricature, la légende importe autant que le dessin : celui-ci n’est là que pour frapper la vue, porte du cerveau. Il ouvre et l’idée entre, plaquée à la légende qui doit être brève et cinglante ; il faut que celle-ci claque comme un coup de fouet, que grâce à sa concision elle puisse se faufiler dans un coin de la mémoire et s’y pelotonner, inexpugnable.
Une légende filandreuse se lit à peine et n’est jamais retenue : elle ne porte pas.
Je le répète, c’est une formule d’art très spéciale que la caricature. On ne s’improvise pas caricaturiste : il faut avoir dès l’enfance, tenté de reproduire, en les grossissant, les ridicules de son entourage. Il faut peut-être aussi avoir été comprimé par des parents autoritaires pour que la révolte éclate plus tard dans les œuvres. Il faut surtout posséder un tempérament d’une extrême sensibilité afin que le moindre contact avec les laideurs environnantes provoque l’indignation.
Le fumier hâte l’éclosion des fleurs : je souhaite que de l’actuelle putréfaction sociale jaillisse une belle gerbée de redoutables caricaturistes, de véritables « humoristes ».
Jossot, 1911.

J’ai accompli, hier soir, un acte d’une extrême gravité : devant plusieurs témoins, j’ai prononcé, en toute conviction, la formule de la Chaâda : Laïlaha il Allah. Mohammed raçoul Allah.
De ce fait, je suis musulman.
Les personnes qui me connaissent ne devront donc pas s’étonner de me voir coiffé d’un pot de fleurs renversé. Je compte bien, sous peu, remplacer cette coiffure inesthétique par le turban et jeter aux orties ma défroque de roumi. Si je me déguise durant quelque temps en marchant de cacahuètes, c’est pour ne point effaroucher mes nouveaux coreligionnaires qui, devant un brusque changement de costume, pourraient croire ma conversion simplement motivée par une fantaisie d’artiste désireux de se vêtir en arabe.
Je voudrais pouvoir détailler les motifs qui ont déterminé mon acte ; mais le cadre d’une chronique ne peut suffire à cette explication : c’est un bouquin qu’elle nécessite. J’achève d’écrire ce volume : il paraîtra prochainement, inchallah. En attendant, voici toujours quelques impressions succinctes.
Ce n’est pas pour avoir droit à quatre épouses légitimes et à un nombre illimité de concubines que je me suis fait musulman : à mon âge, on se contente aisément de la monogamie.
Quand je suis sorti du néant où je me trouvais si bien, on m’a bombardé catholique romain et citoyen français sans me demander mon consentement. Je reconnais qu’il est impossible d’interviewer un fœtus sur ses convictions politiques et religieuses ; mais on pourrait attendre que ledit fœtus ait de la barbe.
La mienne s’étant mise à blanchir, je me suis conféré le droit de choisir ma foi et ma patrie : j’ai opté pour la religion musulmane qui est aussi une nationalité.
L’islamisme sans mystère, sans dogme, sans clergé, presque sans culte, est de toutes les religions la plus rationnelle ; aussi l’ai-je adoptée, estimant que la créature n’a pas besoin de passer par l’intermédiaire des prêtres pour adorer son Créateur.
Tout récemment, désireux d’acquérir une foi, j’ai torturé ma raison afin de l’obliger à accepter des fables tellement extravagantes que ceux qui me les contaient avouaient ne pouvoir les expliquer : ils me demandaient de croire sans comprendre.
Au contraire, dans la religion du Prophète, tout m’apparut simple et sublime comme la Vérité.
La Beauté de la vie orientale fascinait, depuis longtemps, mon imagination d’artiste : mon amour de la rêverie, mon dégoût de la Civilisation, tout m’incitait à une transformation totale.
Après bien des tempêtes, me voici enfin arrivé au hâvre [sic] où je pourrai me reposer en goûtant la grande paix de l’Islam.
ABDUL KARIM JOSSOT, 1913
Vous me demandez de collaborer à « Tunis Socialiste ». Vous savez bien que je ne suis pas socialiste. Je ne suis pas non plus communiste, ni républicain, ni royaliste ; je repousse toutes les étiquettes. Vous savez aussi que je méprise les dirigeants et que les dirigés me font de la peine ; que j’ai horreur de la politique, cette chose immonde ; que je n’ai jamais consenti et que je ne consentirai jamais à me salir les doigts au contact d’un bulletin de vote.
Alors que pourrais-je écrire en votre nouvelle feuille ? Toutes les idées que j’émettrais se colletteraient avec les conceptions de votre conscience relative si différente de votre conscience absolue. Je proclamerais, par exemple, l’inutilité de l’effort ; je montrerais que l’agitation est au cœur de la folie et que la Sagesse se trouve dans l’inertie séculaire de l’Islam ; je reprocherais aux « Néo-civilisés » d’abandonner leurs nobles attitudes ancestrales pour se lancer dans la tourbillonnante activité ponantaise ; je leur expliquerais que les Occidentaux sont nés en des pays tristes et froids où ils sont obligés de remuer pour se réchauffer tandis que la température de l’Orient prestigieux exige les siestes prolongées ; je montrerais que le travail qui a pour but le gain est l’abjection suprême, qu’il est antinaturel et exalterais la paresse comme la plus sublime des vertus ; je vous reprocherais, à vous Guellaty, à vous et à vos amis, de vouloir gratifier les bédouins d’instituteurs gratuits, laïcs et obligatoires dont ils n’ont que faire : l’instruction qui vous apparaît comme la panacée universelle est, au contraire, l’une des causes initiales de votre immense détresse ; la science nous crée sans cesse de nouveaux besoins et ne nous procure pas les moyens de les satisfaire. Ah ! qui nous ramènera aux temps bénis de la Sainte Ignorance ?...
Je vous prouverais que la Civilisation est détestable ; que plus l’Homme s’écarte de la Nature plus il souffre ; que votre prétendu Progrès est un Regrès [sic] ; que les inventions mirobolantes et le perfectionnement du machinisme contribuent, pour une large part au malheur de l’Humanité et que le véritable commencement c’est l’évolution de l’Esprit. Qu’avons-nous découvert dans le domaine philosophique depuis les Grecs ?... Rien.
J’écrirais encore bien des choses dont vous vous ébaubiriez car mes idées ne sont pas celles de tout le monde : vous ne voudriez tout de même pas qu’un artiste pense et s’exprime comme un Philistin, qu’il bêle avec les moutons du troupeau.
Ne croyez pas, cependant, que je m’évertue à cultiver le paradoxe : sous leur légèreté apparente mes propos sont sérieux, et même je possède une réserve d’arguments contre les objections.
Je pourrais encore vous dire que je suis infiniment plus révolté que vous sans être révolutionnaire ; j’estime que les chambardements sociaux n’ont jamais modifié que les mots sans supprimer les maux. C’est l’individu qui doit opérer la révolution en lui-même ; en portant la torche dans ses ténèbres, il s’apercevra que les écuries d’Augias sont encore encombrées d’ordures mentales, d’opinions fausses, de préjugés, et qu’elles ont besoin d’un rude coup de balai.
Si chacun de vous procédait au ramonage de son for intérieur, vous constateriez tous que la révolution sociale s’accomplit d’elle-même, qu’elle se fait toute seule, comme la queue du chat est venue sans qu’on la tire. Ce n’est donc pas dans le macrocosme visible qu’il faut agir, mais dans la région la plus invisible du microcosme, dans la pensée individuelle.
La planète sur laquelle nous végétons n’est qu’une sale boule de crottin ; or il n’y a rien à tenter sur le fumier : plus on le remue plus il pue.
Voilà, cher ami, ma profession de foi très succincte : je regrette qu’elle ne soit pas dans la note de votre journal : si j’adoptais une autre façon d’envisager les êtres et les choses je ne serais plus Jossot, votre
ABDOUL-KARIM JOSSOT, 1921
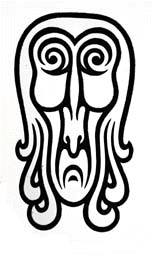
Je dînais, l’autre soir, au « Souffle du Zéphir » en compagnie de deux Français et d’un Arabe. Quand j’ai connu ce dernier, il y a dix-huit ans, il était encore un gosse qui se servait de ses fonds de culotte pour astiquer les bancs du collège Sadiki. Depuis je n’ai pu m’habituer à le considérer comme un homme ; je ne mets jamais de gants pour lui parler.
Au dessert il pérora : il se lamentait sur le sort de sa race ; il confectionnait une « chakchouka » avec l’instruction des mosquées, la suppression du voile, la transformation de la justice indigène et nous servait ce plat gratiné d’autres inepties. N’allez pas croire qu’il était ivre : nous avions bu très modérément.
Dès ses premiers mots je lui avais tourné le dos et j’affectais de contempler silencieusement la mer tout en lançant la fumée de ma cigarette contre le pseudo-Zéphir qui, ce jour là, soufflait en tempête.
En discourant, mon bavard me reluquait à la dérobée, car il me connaît bien et mon attitude le fixait d’avance sur mon opinion. Enfin il se décida à s’arrêter, et m’interpella : « Eh bien ! Il me semble que vous ne m’approuvez pas ? »
Je fis volte-face et lui répondis : « Je me fous de votre race ; je m’en fous éperdument, autant que de la mienne et ce n’est pas peu dire. Pour moi les races ne comptent pas ; seuls les individus m’intéressent.
Vous venez de nous faire une véritable conférence : vous nous avez débité une kyrielle de lieux communs sur le ton emphatique que prenaient jadis, pour vous abrutir, les pédagogues du collège Sadiki. Vous les aviez en si grande estime vos maîtres ; vous les vénériez tellement, vous le bon élève bien sage et très respectueux, que vous avez conservé jusqu’à leur pédantesque façon de s’exprimer.
Voyez combien vous et moi nous sommes dissemblables : quand j’étais potache je méprisais mes professeurs et mes pions autant que je les détestais ; je me faisais une gloriole de passer pour un cancre et un indiscipliné ; je répétais souvent les paroles de La Fontaine : « Notre ennemi, c’est notre maître ».
L’esprit de révolte a contribué au développement de ma personnalité ; sans lui je n’aurais rien obtenu ; avec son aide j’ai résisté aux cuistres qui s’évertuaient à intensifier ma mémoire pour déformer mon cerveau et m’empêcher de penser par moi-même. Petit à petit je me suis délivré de tous les mensonges.
Croyez-moi ; entreprendre votre propre libération importe plus que de tenter de libérer autrui. Avant de songer à revendiquer quoi que ce soit pour votre race faites la révolution en vous-même.
– Mais c’est de l’égoïsme, s’écria mon interlocuteur : je me dois à mes frères autant qu’à moi-même car on nous traite comme des esclaves.
– Est esclave qui consent à l’être, lui répliquai-je : il n’existe pas d’ergastule pour la pensée, celui dont la raison est libérée n’est plus un esclave. Sachez conquérir votre liberté intérieure et vous comprendrez que toute action extérieure est vaine : rien ne deviendra modifiable tant que les hommes ne se transformeront pas.
Admettons que vous réussissiez à obtenir gain de cause, vous recommenceriez immédiatement à revendiquer autre chose et il n’y aurait aucune raison pour que cela finisse ; mais lorsque la paix sera établie en vous, vous envisagerez les événements sous un angle différent : vous les considérerez au point de vue individualiste et vous ne bêlerez plus avec le troupeau.
Individualisme n’est pas synonyme d’égoïsme, ainsi qu’on est trop souvent porté à le croire : l’individualisme est une doctrine morale qui ne fait appel qu’à la conscience de chacun. Cette doctrine nous astreint à mettre nos actes d’accord avec notre pensée, à ne nous attacher qu’aux richesses spirituelles qui sont en nous, et à ne pas envier les biens du dehors.
Elle nous dicte certains devoirs, entr’autres celui d’aimer tous les êtres vivants : elle nous apprend aussi à supporter les horreurs de la civilisation avec stoïcisme et indifférence, car ces horreurs appartiennent au-dehors et ne doivent pas affecter notre raison.
L’individualisme nous montre que l’humanité ne progresse pas moralement et que les progrès matériels qu’elle a réalisés n’ont servi jusqu’ici qu’à nous rendre l’existence plus difficile en nous créant des besoins nouveaux.
Il nous apprend que le bonheur est intérieur et individuel et que vouloir faire le bonheur d’une race est un non-sens puisqu’on ne peut produire le bonheur qu’en soi-même.
Il nous dit encore que l’opprimé qui ronchonne aspire à devenir oppresseur ; que les révolutions ne changent pas les choses mais seulement leurs noms ; que la haine engendrera toujours la haine et que la violence ne s’abolit pas par la violence.
En un mot l’individualisme nous enseigne la Sagesse.
Le sage n’attache aucune importance aux formes gouvernementales et ne fait point appel au pouvoir pour obtenir des adoucissements à sa vie non plus qu’à celle de ses semblables : il sait que l’injustice sociale est indestructible ; mais il s’efforce, autant que cela lui est possible, de réparer les injustices particulières.
S’il constate son impuissance devant la tyrannie, il s’interdit, du moins, d’être un tyran et refuse d’exercer certaines fonctions rétribuées par le gouvernement et qui l’obligeraient à emprisonner, à condamner ou à tuer.
Il ne commet jamais le péché d’obéir à moins d’y être contraint par force, car il ne doit l’obéissance qu’à lui-même. Enfin il s’efforce de pratiquer l’amour et la pitié.
Je ne saurais mieux terminer qu’en vous conseillant de suivre cette ligne de conduite ; imprégnez-vous de la doctrine individualiste ; transformez-vous et la race vous apparaîtra comme une des monstrueuses idoles qu’adore le stupide Pecus prénommé Vulgum.
Abdou-’l-Karim JOSSOT, 1930.
« Quel mal est comparable à l’alcool ? » écrivit, un jour, Edgard Poë. Il aurait plutôt dû tracer : « Quel mal est comparable à la pensée ? ».
Soucieux du bonheur de leurs dirigés, les dirigeants s’efforcent de les soustraire à ce terrible fléau. Ils n’y parviennent pas toujours ? Ah ! s’il leur était loisible de comprimer les caboches entre les ais pour supprimer toute germination d’idées !... Nous devrions leur être reconnaissants : ces bons bergers veulent notre bonheur ; ils le désirent ardemment comme jadis les prêtres qui brûlèrent Jeanne d’Arc voulaient le bonheur de la pauvre fille ; ces saints hommes étaient persuadés qu’en la faisant rôtir sur le bûcher ils la libéraient des flammes éternelles.
Les victimes manquent de gratitude envers leurs bourreaux ; elles ne savent pas apprécier l’amour qu’ils ont pour elles. Les Tunisiens ne se rendent pas compte qu’on les châtie parce qu’on les aime bien ; c’est la sempiternelle histoire du gosse à qui son père flanque une raclée : il la trouve saumâtre, malgré que les coups lui fassent moralement le plus grand bien. Entendez-vous, Tunisiens ? C’est pour votre bien que votre père le Gouvernement vous tarabuste de temps en temps. Quel déplorable état d’esprit est le vôtre ! Vous vous rebiffez contre cet excellent père, alors que vous devriez le bénir. Il veut vous empêcher de penser : n’est-ce pas tout naturel et cela ne prouve-t-il pas sa paternelle sollicitude ? Songez donc combien vous seriez heureux si vous ne pensiez plus. Ah ! vivre la vie végétative des vaches qui, d’un œil atone, regardent passer les trains dans la prairie !...
La pensée est une dépravation de l’esprit ; elle est un sujet de tourment continuel ; si vous la laissez vadrouiller au gré de sa fantaisie, elle risque de générer des idées qui ne sont pas celles de tout le monde. Que Dieu et son associé Monsieur Manceron vous préservent de cette calamité !
L’homme n’est pas un roseau pensant : il a été créé et mis au monde pour ruminer, non pour torturer ses méninges. C’est le démon de la perversité qui le pousse à mettre sa cervelle au beurre noir. Les gens qui ne pensent pas sont bien heureux et il y a plus de gens heureux qu’on ne pense.
Le bourgeois, s’il faut en croire Flaubert, est « celui qui pense bassement. » L’auteur de Salammbô s’est, sans doute, trompé : issus de la bourgeoisie, la plupart de nos fonctionnaires... Aïe ! Ami Jossot ! Dans quelle fichue phrase t’embarques-tu ? impossible de t’en sortir sans te mettre en contravention avec les décrets scélérats qui interdisent de débiner les fonctionnaires. Tu n’ignores pas que le droit t’est refusé de formuler, même à voix basse ce que tu penses de ces respectables messieurs ; mais, comme la science n’a pas encore trouvé le moyen d’emprisonner la pensée, tu restes libre de penser ce que tu veux sans le dire ni surtout l’écrire. Ou, plutôt, tu peux l’écrire en recourant à des périphrases et à des circonlocutions ; mais la diplomatie n’est pas ton rayon : suspens donc un instant ta plume au-dessus de ton papier et... continue. Pour se débarrasser de la pensée gênante, les dirigeants de la Tunisie ne trouvent rien de mieux que de supprimer les feuilles arabes. Ils devraient pourtant savoir que la chute des feuilles ne modifie pas l’état des esprits puisqu’aux feuilles mortes succèdent, tous les ans, de nouvelles feuilles.
Il faut qu’ils soient bigrement dépourvus de psychologie pour oser s’attaquer à la pensée : elle est intangible. Plus on la traque plus elle se fortifie ; c’est dans la lutte qu’elle se manifeste pleinement, dans toute sa véhémence. Quand on essaie de l’endiguer, elle se rue et bouleverse tout.
La meilleure méthode pour la combattre c’est de ne point paraître se soucier d’elle ; si on la pousse à bout, elle atteint les extrêmes limites de la violence. Vous avez tous entendu parler des idées qui sont dans l’air. Eh bien ! Quand on croit avoir supprimé la pensée en supprimant ses moyens matériels d’expression, elle agit de ruse ; elle répand dans l’air des idées d’insubordination et c’est ainsi que les oppresseurs deviennent les dindons de leur mauvaise farce.
C’est là, bien entendu, simple façon de m’exprimer : loin de moi l’intention de comparer à des dindons les brimeurs de la pensée ; il ne faudrait pourtant pas me faire dire ce qui n’est pas dans mon ciboulot.
Avec ces sacrés décrets scélérats on ne saurait prendre trop de précautions. Me voyez-vous, à mon âge, étendre mes rhumatismes sur la paille humide ? Pas de ça, Rosette !
Mieux vaut m’arrêter. Qui sait à quelles incartades se livrerait ma plume ? Elle me paraît, aujourd’hui, disposée à piétiner les bégonias. Peut-être, après tout, subit-elle l’influence des idées qui sont dans l’air ?
Abdou-’l-Karim JOSSOT, 1931.
Je vis en dehors du troupeau ; je vous fuis tous, vous, vos bergers et vos chiens.
J’ai dit adieu à tout ce qui vous passionne ; j’ai rompu avec vos traditions ; je ne veux rien savoir de votre société maboulique ; ses mensonges et son hypocrisie me dégoûtent. Au milieu de votre fausse civilisation je m’isole ; je me réfugie en moi-même ; je ne trouve la paix que dans la solitude.
Je ne veux plus vous fréquenter ; je me gare de vous, car vous êtes tous atteints de folie : vous vous précipitez pour vivre plus vite ; vous vous hâtez, vous courez, vous vous bousculez. Votre existence enfiévrée vous empêche de penser, de rêver, de sentir. Et toute cette frénésie n’a d’autre cause que votre âpreté au gain : gagner de l’argent est pour vous la loi suprême ; vous enrichir, voilà votre but unique. Vous ne savez que travailler, transpirer et voter.
C’est pour le sale argent, ce dieu de notre sale époque, que vous déclarez la guerre ; c’est pour lui que vous tuez ou vous faites tuer. Vous vous rendez malheureux pour lui ; vous vous épuisez, vous vous suicidez pour lui. Il ne vous vient pas à l’idée de restreindre vos besoins, de supprimer en vous les désirs, de pacifier vos cœurs. Pas un d’entre vous ne manifeste l’intention de rompre avec l’infernal état de choses actuel.
Ah ! C’est que vous avez été lancés dans l’engrenage dès votre naissance. Que dis-je ? Avant que vous ne veniez au monde, votre sort était déjà décidé, votre vie tracée et, dès que vous avez fait votre apparition, on vous a soumis à toutes sortes d’influences, familiales d’abord, scolaires ensuite, plus tard militaires, et enfin sociales.
On vous a appris à calquer votre existence sur celles de vos parents ; on a dirigé vos sentiments ; on a étouffé vos aspirations ; on vous a enseigné une morale ; on vous a inculqué des croyances religieuses ; on vous a prescrit des obligations civiques, des devoirs mondains ; on vous a pétris, malaxés, triturés ; on vous a broyés sous toutes les conventions, sous tous les préjugés, sous toutes les erreurs.
On vous a imposé des règles ; on vous a entouré de contraintes ; on a dressé devant vous des barrières ; on vous a assigné des limites ; on vous a forgé des chaînes.
On a tellement annihilé votre individualité que vous avez perdu jusqu’à la conscience de vous-même. Et quand un non-conformiste, faisant table rase des fausses valeurs, cherche à vous expliquer le sublime poème de la vie ; à vous dévoiler la vérité ; à vous dénoncer les artifices qui la dénaturent, les conventions qui la mutilent ; les mensonges qui l’enlaidissent, vous refusez de l’écouter. S’il essaie de purifier votre esprit en l’élevant au dessus des miasmes morbides qui se dégagent de la matière ; s’il vous prêche la vie intérieure, la seule qui soit digne d’être vécue, vous ricanez et vous le traitez de fou, vous les aliénés.
Sous-humains rassemblés en troupeaux, vous avez tous la même mentalité grégaire ; vous bêlez tous, sur le même ton, les mêmes lieux communs. C’est pourquoi je vous fuis, vous, vos bergers et vos chiens.
JOSSOT, 1939.

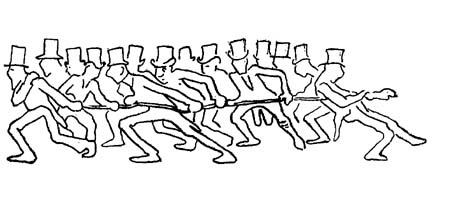
Copyright © Henri Viltard, janv. 2008
Toute reproduction sur le web devra faire l'objet d'une autorisation de notre part.
La reprise partielle des contenus est autorisée, mais elle doit obligatoirement être assortie de la mention du nom de
l’auteur, de la source, et d’un lien pointant vers le document original en ligne sur le site.
